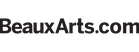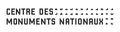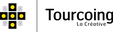Un corps qui bouge
Il arrive que, quelles que soient les atteintes, un corps ne meurt jamais. Il répond à ce qui le blesse, le met en danger, par un surcroît de présence. Sa disparition ne le rend-elle pas, au contraire, plus vivant ? Dès lors qu’il n’est plus, nous ne cessons de le chercher. le corps bouge avant et après la mort. Il n’y a pas de corps sans cela et de cela, le rêve nous instruit. Plus il est menacé d’oubli ou de destruction, plus nous puisons, dans les forces durêve, un élan qui le métamorphose et le rétablit. Dans la période que nous vivons, où le corps est sur la sellette, où nous est annoncé son évitement, ses évanouissements, sa dématérialisation, le rêve et l’utopie ne cessent de nous rappeler qu’il est toujours sur scène et pour longtemps...
Sur scène ou plutôt sur une des scènes multiples où il passe de l’une à l’autre. Jamais immobile, appelant le mouvement, la danse comme une respiration relançant les battements du cœur.
Par cette impulsion, il s’impose au centre, mais étrangement cette course, par sa vitesse, l’efface en le manifestant, par sa seule lumière qui nous éblouit. Par cette situation, le corps doute de lui-même. Il apparaît, il se dessine dans l’espace, mais l’intensité des lueurs n’est pas son alliée.
Elle le met en question. Il lutte contre une ombre qui le menace et dans laquelle il ne se reconnaît pas. S’il s’identifie d’abord aux lignes qui le cernent, qui lui permettent d’exister, de dire « je », le monde, joueur des multitudes lumineuses, le trouble et le défait. S’il est celui qui vient, il est aussi celui qui fuit. D’abord tache sur la terre, il se liquéfie dans une dilatation ou s’évapore dans une expansion dont nous perdons les confins. notre corps se disperse, se dissémine, et nous serions naïfs de croire en ses définitions physiques ou lexicales. Un temps, il est une évidence, mais celle-ci laisse place à l’inconnu où le salut se trouve dans l’occultation des apparences. Il se réfugie en un « noir » qui envahit l’espace et le recouvre, ayant pour vêtement les ténèbres de la nuit jusqu’à ce que l’éclairement, nécessaire à toute vie, relance la quête d’un être insaisissable, à travers l’image qui renaît.
À ce sujet, Junichiro tanizaki nous pose cette question : « avez-vous jamais, vous qui me lisez, vu la couleur des ténèbres à la lueur d’une flamme ? Elles sont faites d’une autre matière que celle des ténèbres de la nuit sur une route et, si je puis risquer une comparaison, elles paraissent faites de corpuscules comme d’une cendre ténue, dont chaque parcelle resplendirait de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. »au contact des œuvres de Panorama 23, j’éprouve cette sensation d’un territoire composite de cendres retournées par l’art en une suite de couleurs, réfractées dans l’eau et la lumière.
Répondre au délitement du monde par la danse, l’explosion bigarrée, traverser et spéculer avec ce qui l’éclaire ou l’efface, du noir au blanc, n’est pas une affaire de solitude. Éprouver la variabilité de ce va-et-vient, de cette métaphore, implique l’altérité, réclame l’autre qui invite au changement, à la fusion de substances différentes.
Cet autre est présent de façon insistante dans ce Panorama 23, il est la source et le flux du courant qui lie les œuvres. S’avancer par les chemins de l’exposition, c’est plonger dans un univers dont le principe est le croisement, le mélange, l’abouchement, comme il en est dans les mouvements de la mer, dans ses fonds marins. les créateurs réunis ici questionnent le corps et le langage, ils m’évoquent l’introduction de Moby Dick où Herman Melville définit son héros comme un nageur debibliothèque. oui, il s’agit bien de plongeurs qui nous emportent dans des flux qui sont la nature du monde où les corps se baignent, jusqu’à devenir le flux lui-même, cherchant à se fondre avec le corps de l’autre. Ils rêvent d’un corps possible où le morcellement, la coupure, la division sont effacés par les ressacs, les reflets d’une vague, insufflant le rythme au monde.Ce rythme engendre des suites infinies de glissements, projections, de fondus enchaînés où s’abandonne la différence des genres, où les règnes s’accouplent pour faire naître des corps en suspens, des sujets réels, travaillés sans cesse par le virtuel des mythologies ou des sciences-fictions. Ils sont des blocs de pierre tout autant que des fantômes, des nageurs, comme des noyés. Ils parlent vrai tout en chuchotant qu’ils ne sont qu’acteurs et artifices. Un de leurs états est semblable à celui des objets abandonnés, « aux restes », qui deviennent espaces sacrés, idéalisés, auréolés par des énigmes faisant de notre perception une quête initiatique.
Ici, les corps peuvent être soumis par la réification pour, dans l’instant suivant, la faire voler en éclat grâce à la puissance d’une pensée onirique. Ici les héros sont aussi les dormeurs, ou ceux pour qui le sommeil est une leçon. Dormir, aujourd’hui, est héroïque. Bien heureux ceux qui, pour connaître le monde, choisissent d’en être les dormeurs actifs.
« Mourir, dormir, rêver peut-être », écrit William Shakespeare au cœur du monologue d’Hamlet, qui par cette formule livre son secret. Cette trilogie, ces trois actes indissociables ne forment qu’un principe, un seul état, une seule pensée cherchant à se libérer et à s’offrir les chances d’imaginer un nouveau monde. Un monde où s’observe le travail d’abolition entre l’humain, le végétal et l’animal. Georges Bataille serait heureux de voir qu’il s’incarne dans la présence et les déambulations d’une panthère noire, vecteur de la connaissance grâce à une mystérieuse dépense d’énergie, une course vive. la transparence traverse cet univers, à la manière de Sebastiano Mazzoni, de Francis Picabia ou de François rouan. le végétal envahit l’architectural, puis l’animal, pour se fondre enfin en anatomies humaines irriguées par les humeurs, les liquides, l’eau qui composent nos larmes, rappelant notre nature fluide et volatile, entre mémoire et épanchement. Si une part de la vie est recelée dans nos os, comme l’imagine Edgar Poe ou l’artiste roy adzak, ces os ne pèsent pas, n’immobilisent pas car ils sécrètent les rêves, véritables acteurs des bouleversements qui nous déterminent. Sont-ils l’identité la plus fiable de notre corps, comme le proposent ces œuvres, dont l’une s’origine dans le thème philosophique et poétique du « change » d’Orlando de Virginia Woolf, alors que d’autres mettent en scène la « forme monstre » ou les corps électriques de lovecraft.
Quel est le réel de ces corps ? Celui d’un paradoxe où le plus physique, le plus matériel se manifeste par le virtuel le plus insaisissable. Celui des Ailes du désir de Wim Wenders ou celui de t.S. Eliot cherchant à formuler son désir d’incarner l’écriture par une parole improférée, une parole silencieuse. Un des artistes de Panorama 23 note : « J’aimerais pouvoir dire, tenter le silence dans la parole. » l’écriture peut être une maison qui quitte ses assises, se retourne en barque pour suivre son chemin vers la mer, par la rivière, vers les figures du rêve.
Une maison ? Une barque ? Singulières « anima » ? Je me souviens, aujourd’hui, d’une question posée à un danseur derviche, évoquant sans cesse l’âme : « Mais qu’est-ce que l’âme ? » Je me souviens mieux encore, en 2021, à tourcoing, de sa réponse : « Mais le corps bien entendu !
Olivier Kaeppelin
- Ana Elena Tejera - House Type 104
- Anaïs-Tohé Commaret - Ce qui nous pousse
- Chuxun Ran - Une adresse au monde
- Céleste Rogosin - Clear Jail Minotaur
- Faye Formisano - They Dream in My Bones
- Guillaume Delsert - Les nimbes
- Inès Sieulle - Parade
- Isabella Hin - Fight or Flight
- Juliette Dominati - L'île flottante
- Olivier Bémer - Noon
- Samuel Lecocq - La Communauté des Larmes
- Vera Hector - Le soleil brillera toujours
La terre et le ciel
L’âme et le corps, les frontières, les fractures entre matériel et immatériel, les jeux qui proposent de les abolir... Ici le réel et le virtuel sont ensemble sur un fil funambule. l’empiriste David Hume écrivait : « tous les matériaux de la pensée sont tirés de vos sens, externes et internes, c’est seulement leur mélange et leur composition qui dépendent de l’esprit et de la volonté 1. » Dans Panorama 23, il ne s’agit donc pas du choix d’un idéalisme exalté ou d’un goût prononcé pour une magie des illusions, mais bien plutôt d’une réponse à la réalité du monde par l’expérience. la question est alors d’étayer notre pouvoir créateur sur ce qui nous permet de concevoir cette réponse, sans négliger aucune de ses dimensions, en particulier celle du rêve. Celle-ci ne se contente pas de l’accomplissement physique du vol pourtant si proche des légendes oniriques. Ce signe ascendant, cette élévation, que nous permettent-ils ?
Un avion, un planeur, présents dans une des œuvres, ne sont plus les assemblages d’Icare ou de simples mécaniques, mais des véhicules mentaux, des traductions, d’une nature à l’autre, qui en disent beaucoup sur nos capacités de vivre « ailleurs », au-dessus d’une ligne d’horizon, qui « éclairent » autrement les connexions des synapses de nos vies cérébrales.
Cette énergie transformatrice nous projette au-delà. Débordant l’écosystème entre le ciel et la terre, elle génère la conscience d’un corps, désormais parcelle vivante du cosmos. Ce corps cosmique est solidement attaché aux jours et aux heures de nos vies, entraîné en une déambulation permanente au sein de l’espace, composé des territoires instables de la mémoire et des forces lancées vers je ne sais quelle rive. Si nous ne les maîtrisons pas, c’est parce que nous sommes entre leurs chorégraphies les liant et les déliant. nous appartenons à l’histoire de nos corps mais nous la dépassons sans cesse pour des univers que nous cherchons à habiter ou dans lesquels nous nous projetons sur des écrans visibles ou invisibles. Dans ces films, des êtres humains naissent ou s’éteignent. J’entends à peine leur souffle. leurs yeux sont fermés... ils dorment. Sont-ils plongés au fond d’eux-mêmes, fascinés par les teintes humorales, les circulations sanguines, les secrétions qu’ils sont, en secret, les seuls à voir, comme autant de spectateurs solitaires ? Contemplent-ils leur nature abstraite, leurs territoires internes, leurs ballets colorés, leurs multiplications ou leurs disparitions.
Il faut lâcher, alors, les codes de la réalité pour le réel et ses multiples manifestations à l’écart des lexiques. le corps n’est plus devant nous. Il s’est transformé en une poignée d’obscur, une terra incognita, ou l’arbre, le Tree of life de terence Malick dont nous supposons les lignes qu’il trace, depuis l’entrelacs de ses racines jusqu’au bleu du ciel. Étrange généalogie dont le personnage central est la naissance.
Il y a dans Panorama 23, un rêve qui s’épanouit à partir des inductions de la nature. Elles sont à la fois les acteurs, leurs songes et les scènes qui les accueillent. l’important est, alors, qu’entre les lignes, chaque lapsus, chaque vide, chaque absence, chaque tempête, chaque éclipse, relance le rythme. l’essentiel est la confiance en une continuelle genèse que la musique accompagne, ostinato, spirale sonore qui, s’abandonnant à son propre mouvement, gagne tout l’espace pour nous offrir un lent émerveillement. l’éclosion d’une fleur, d’une écriture, d’une création magnifie cet espace grâce à la surprise et à la beauté de leur croissance. Croissance fascinante du rose, d’une pleine couleur, rose de l’aurore, celui de la chair, rose de Goethe, celui de Guston, ou de Gertrude Stein, « a rose is a rose is a rose is a rose... »
Ce désir, ce plaisir, cette jouissance offrent à notre corps la chance d’être plus grand que soi, animé par le sentiment océanique ou l’infini d’un ciel sans bords, d’un sommet, d’une couleur, sans attribut. Cette couleur peut être le bleu du ciel, de Georges Bataille, de Franck Venaille, le blanc du cosmos ou encore le vert secret d’un brin d’herbe, infime dans l’univers. Ce secret, les artistes nous invitent à le découvrir. Le secret comme source d’émotion et de pensée. Est-il caché dans le tapis, circule-t-il dans les écheveaux de Panorama, le labyrinthe des œuvres ? C’est lui qui donne sa puissance à la création, comme le souligne anne Dufourmantelle : « C’est une force motrice dont on explique mal la créativité. Ses liens avec la mémoire et le langage, notamment dans son rapport au rêve, sont l’objet d’enquêtes et d’expériences qui nous conduisent à repenser l’imagination. (...) le secret qui se révèle dans l’imaginaire n’est jamais une mise à sac ou un arrachement, c’est un monde de lumière et d’ombres où l’on se déplace comme un animal 2, à l’instinct (...) le secret reste le trait qui lie efficacement la vie du désir et la possibilité qu’offre le réel de le recevoir. on suppose donc au réel d’être révélateur d’un désir auquel il offre une possibilité de fixation et de répétition. En reliant divers moments de notre vie, de jour comme de nuit, la vie secrète de nos désirs confère son visage à notre plaisir. n’est-elle pas cette fixation hors parole d’une image ?
Comment dès lors la dévoiler sans mettre en périls, le fragile édifice d’arrêt sur image et donc d’arrêt du temps sur lequel il repose. »les installations, les films de Panorama la dévoilent, en « reliant les divers moments de notre vie de jour comme de nuit ». Ils sont à la recherche d’une image et, dans le même temps, la bouscule, la défont, s’en libèrent pour toucher du doigt une matière non grammaticale et d’autant plus mobile. Je la perçois mais je ne peux la traduire. Plutôt que de la chercher à travers les énoncés, je m’attarde sur les blancs du discours, ses points aveugles, ses effacements, en vérité, une fois de plus, sur son énonciation dont le rythme heurté en dit plus que l’illusion d’une narration. C’est pourquoi dans ce Panorama, les technologies les plus avancées font signe aux techniques rudimentaires, « primaires » ou vernaculaires de l’art brut. C’est là, je crois, que se tient la preuve de la puissance créative du secret. Il nous empêche de dire et permet ainsi de créer en empruntant des chemins de traverse.
À ce sujet, anne Dufourmantelle écrit : « Ce qui fait son pouvoir est aussi d’être au-delà du bien et du mal. Se construisant au tout début du bien et du mal. Se construisant au tout début de notre rapport au langage, il n’est pas étranger à la conscience morale mais il la déborde. Il impose en nous sa valeur d’atout, c’est-à-dire ce qu’il troque, ce qu’il augmente au contact du réel et se déploie dans les interstices du manque, de la frustration, de l’attente, dans les délices du rêve, du premier toucher, des premières sensations, des premières visions.
»Éclipses, égarements, disions-nous, mais aussi présence d’un espace-temps intercalé entre deux mondes, d’un corps hybride, ou encore d’un corps s’échappant comme le corps de loup. Dans ces territoires « écartés », chacun est confronté au vide, aux désordres du vent qui renversent, aux mirages et aux chants des sirènes de l’Odyssée. Plus que sur des routes, ou des parcours balisés, nous sommes « au milieu du carrefour », à la recherche de « ce qui vient ». En art, l’essentiel n’est jamais le programme mais l’archipel des expériences, le pressentiment ou la conscience d’un choix. Certaines œuvres nous rassurent en nous donnant la certitude de « voir », avant que d’éprouver que ce qui est proche s’éloigne, que le sens se voile. la vue qui ainsi s’élève ne saisit plus le motif, se trouble, s’aveugle volontairement, pour retrouver le réel « autrement », non plus en une saisie directe mais dans les dédales du secret que l’on cherche. Désormais, il ne s’agit plus de vue mais de la libération d’une énergie mentale se détachant de l’objet pour mettre en œuvre une approche, polymorphe et sensuelle.
Dès lors, l’art nous permet de « toucher » le cœur, la peau du réel, sachant que l’un et l’autre s’évanouiront dans la nuit des images, où, entre ciel et terre, nous partons, tâtonnant, à leur recherche : le cœur, la peau...
Olivier Kaeppelin
- Elliot Eugénie - Liesse
- Guillaume Barth - Crocus sativus, fleur du bonheur
- Janaina Wagner - Curupira et la machine du destin
- Judith Auffray - 7h15 - merle noir
- Lina Laraki - Halves Through Night / نصفين الليل
- Lou Morlier - Ensauvage-moi
- Louise Tilleke - Méditation positive
- Magalie Mobetie - Anba tè, adan kò
- Quý Trương Minh - The Woman Next Door
- Santiago Bonilla - Rough-Colored Clouds
- Vincent Duault - Voyager
- Yunyi Zhu - Tout ce qui était proche s'éloigne
Rire et rêver
Ma première surprise est de remarquer que la majorité des travaux de Panorama 23 ne présente pas de discours politiques alors qu’aujourd’hui, les rhétoriques idéologiques reviennent en force.
Après ce premier étonnement, je suis heureux d’observer que cela ne dénote pas un désintérêt pour la société ou les tragédies de la pla-nète : immigrations, dictatures, catastrophes écologiques, massacres, violences machistes, pour ne citer que les plus récurrentes, mais que les créateurs, ici, choisissent des réponses proprement artistiques.
Si ma première réaction est la surprise, la deuxième est le bonheur de voir que ces créateurs ne désertent pas leur territoire, leur langage propre. Ils interpellent, analysent, inventent en rappelant que leur mode d’expression, leur méthode, engendrent d’autres attitudes, d’autres com-positions, d’autres formulations du sens.
Découvrant cela, m’est revenu en mémoire la radicalité de Jeanne-Claude et Christo, avec lequel j’ai présenté, à la Fondation Maeght, le travail de toute une vie sur la forme archétypique du Mastaba, à par-tir de l’utilisation de formes industrielles telles les boites de conserve, les bidons ou les barils. À la vue de ces barils, nombre d’interlocuteurs tinrent des considérations sur le pétrole, l’économie, l’écologie concernant cette éner-gie fossile. Si Christo laissait, bien sûr, les journalistes libres de leur interprétation, il indiquait que ce n’était pas le sujet de son travail et qu’ayant connu cruellement, en Bulgarie, le pouvoir destructeur de l’idéologie, il ne souhaitait pas s’entretenir sur son œuvre de cette problématique. Sans vouloir offenser personne, si son questionneur insistait sur ce thème, il interrompait l’échange, en leur demandant de comprendre sa défiance vis-à-vis de ce mode de pensée qui, selon lui, étouffait l’espace singulier de l’art et de son processus signifiant.
Je crois, en effet, qu’un artiste n’a aucun intérêt à se laisser envahir, coloniser par ces démarches réductrices. S’il y a une « éthique générale », il y a également une éthique de l’art qui détermine son champ propre.
Je me souviens qu’un journaliste lui demanda alors : « mais pour quoi militez-vous ? ». Christo répondit en souriant : « Mais comme toujours, je milite pour l’art, simplement ». Christo signifiait qu’avec les formes qu’il inventait, qu’il choisissait, il construisait « un effet d’art », c’est-à-dire une « rencontre » avec un événement artistique. Il ajoutait, un peu provocateur : « Je crée des œuvres complètement irra-tionnelles, irresponsables, sans justification. » Ainsi, à chacun d’entrer en un contact très libre, très singulier avec l’univers pour le comprendre autrement. Que ce soit la nature, la ville, les enve-loppes sociales ou intimes… cette rencontre se fait grâce à l’art qui use de ses propres géographies et de ses propres chemins. Ce sentiment, je l’éprouve aujourd’hui en regardant ou en vivant les œuvres de Panorama qui, claire-ment, disent leur désaccord avec certaines structures sociales, leurs fonctionnements, leurs insuffisances, leurs injustices, leurs erreurs ou absurdités, mais qui, jamais, ne rendent leurs armes au politique ou à une autorité en matière de sciences sociales. Cela n’implique pas une absence de dialogue mais souligne qu’ils n’ont pas la même économie, ni le même imaginaire. Ce n’est pas un hasard si le souvenir de cette expérience avec Christo refait jour, aujourd’hui, tant j’ai retrouvé au Fresnoy des options comparables.
Je suis heureux de voir la société en débat de cette façon et la place que les artistes s’y assignent, choisissant délibérément que leur langage soit irréductible à d’autres, empêchant ainsi la confusion entre la réalité et le réel.
Là encore, un autre souvenir : celui de Jean-Luc Godard, au Verger Urbain V d’Avignon, en 1967, après la projection de La Chinoise. Assailli de questions d’actualité ou de théo-ries politiques, de demandes d’analyses, il explique qu’il est cinéaste, qu’il faut d’abord regarder le film, l’assemblage des images, de la parole et du son, pour comprendre son propos. Le sens était là et ne pouvait pas être réduit à aucun argumentaire, aucune rhétorique.
Là encore, ces phrases de Léos Carax dans un entretien avec Jean-Michel Frodon : « Jamais aucune idée au départ de mes projets, aucune inten-tion. Mais deux trois images, plus deux trois sentiments. Si je découvre des correspondances entre ces images et ces sentiments, je les monte ensemble. (…) Je ne fais pas de films ouvertement politiques, mais je crois toujours que le cinéma existe pour nous changer, et changer nos angles de vision ».
Christo, Jean-Luc Godard, Leos Carax, autant de manière de dire que l’art, le cinéma, la poésie, ont chacun leur espace, leur régime propre où se cherchent la singularité et l’autonomie de leurs « langues ». Les idées, les sensations, les raisons y ont un autre poids, un autre dessin, une autre forme. C’est ce choix que ne cesse de faire vivre les œuvres de Panorama lorsqu’elles mêlent leurs voix à celles de l’époque et du temps.
S’il s’agit, par exemple, d’expri-mer la douleur générée par le racisme, au travail à bas bruit, la fiction s’en empare, redonne vie à la Vénus hottentote, à son corps morcelé. Elle renverse l’aliénation extrême de ses pauvres membres pour, désormais, les faire rayonner, d’un merveilleux « rose » à travers le moindre de ces fragments dépecés. Ils deviennent formes sacrées dressant un sanctuaire, les préservant de manipulations dont ils furent et dont ils sont encore l’objet.
Devant la confusion des sentiments, les stéréotypes d’époque, la soumission à l’ordre des techniques, les artistes ont recours aux pouvoirs de la surprise, de l’enfance, aux rêves et aux voiles de l’ima-ginaire qui se gonflent et invitent nos vies, de manières inattendues, parfois « tordues », à déjouer l’ordre et les règles, à faire entendre l’humour et l’ironie qui défont les lignes droites, nous obligeant à être « le suivant d’un suivant. »
« Au suivant ! » dirait Jacques Brel. Pigeons. Crânes d’œuf après crânes d’œuf. Ils sont aussi de véritables détona-teurs contre certains personnages de la scène #MeToo. Semblables au Pantalone de la commedia dell’arte, ils sont présents depuis l’Antiquité jusqu’aux grotesques de la Renaissance. Ils ont les traits parfois sans pitié de l’art brut ou portent les grimaces des morphings numériques de Joan Fontcuberta. Leurs corps se déforment, sous l’effet des jouissances du pouvoir et de celles du corps de l’autre.
Beaucoup de jeux de rôles nous interpellent, de scène en scène. Certaines violences s’inspirent des mises en scène, des games de combat parodiant des biographies d’assassins devenus des producteurs de cinéma de série B, remplaçant les duels de valeureux samouraïs.
D’une fiction à l’autre, beaucoup de personnages surgissent et sont traités, non plus pour leurs corps, mais comme des « composi-tions-combinaisons » abstraites, au sein d’allégories ou d’expériences vécues ou rejouées dans le théâtre des installations.
Il arrive aussi que, quel que soit le masque ou la peau du rôle, les person-nages, malgré de volontaires distanciations, ne puissent être soustraits aux émotions mémorielles souvent mélancoliques ou dramatiques, « Persona – Personne – Personnage » se mêlant.
Dora García évoque la déception de femmes toujours dans l’espérance d’un monde à venir qui ne vient pas, l’impossible recon-naissance authentique de leur identité. Le monde se repliant sur lui-même n’offre plus alors que la répétition désespérante des mêmes échappatoires. « Sortir du champ » est alors une aventure dont la force motrice est le rêve.
EXIT, sortir, s’extraire, voilà ce que les peuples de migrants incarnent. Ces peuples qui traversent les terres vers la mer. Ils franchissent les déserts, réparent leurs sandales, pour continuer à marcher, abandonnent leurs bagages, leurs vêtements puis leur vie... Ils ne laissent rien, si ce n’est, grâce à quelques-uns respectant leurs rêves, une tombe sans nom, dans l’espoir qu’un jour une famille, une communauté les reconnaîtront. Qu’en est-il, aujourd’hui, de ces fantômes et des possibilités d’îles imaginaires à atteindre ? Une chanson dit que ce refuge est toujours vivant pour ceux qui les suivent et chantent à nouveau.
La plupart de ces œuvres n’ont pas de narrations formelles mais des élaborations « complexes » inattendues qui nous maintiennent en éveil, à la recherche d’une issue virtuelle au labyrinthe. Je pense à John Cassavetes qui confie à propos de Love Streams : « Faire un film n’a rien à voir avec les actions, la narration, la conti-nuité, mais comment on reste accroché au sujet. À chaque fois que quelqu’un pense qu’il va se passer quelque chose, dans ce film, il se passe autre chose. Bon, ça aurait pu avoir un meilleur plan narratif, mais on fait un film et on se dit : ça pourrait être mon dernier film. Pourquoi j’irais me mettre dans un plan narratif vous comprenez ? Et puis on claque juste après, vous voyez. »
C’est alors que la pensée onirique prend son envol. Elle nous projette dans un journal intime ou une légende, en nous offrant la perspective heureuse de se diriger vers « l’Ailleurs ».
Rien n’est affirmé, ni stable. L’art, la musique, l’amitié, la vie autonome des objets concourent à négliger la seule dimension matérielle de nos vies. Ce que je vois est dépassé par une « autre vue », une connais-sance nouvelle des genres et des règnes. La nature nous incite à faire un pari sur la présence de l’invisible, sur le principe d’incertitude. Le monde est une supposition, potentiellement vérifiable, ce dont, régulièrement, la physique quantique nous informe.
De cette liberté efficiente, le refus d’un système autoritaire de perception et d’interprétation est le garant. Il n’affronte pas le politique, il le contourne, le désamorce. L’hypothèse est clai-rement de choisir l’Ailleurs, comme analyseur de notre situation. Ici, les œuvres cherchent à l’atteindre en mixant le rêve, la science, l’uto-pie, les déplacements de la pensée, le mouve-ment, paradoxalement, plus concret que toute fondation.
Imaginons une ville. Ce n’est pas son bâti qui la fait vivre, car la ville est une étoffe brodée d’habitants, d’arbres, de temps, de mémoire, de cir-culations et de frémissements. Son réseau est un réseau sanguin. Il fait et défait sans cesse la carte. Épiderme rêvant une fiction entre science et animisme.
Olivier Kaeppelin
- Alice Brygo - Soum
- Amélie Agbo - Vénus
- Che-Yu Hsu - The Making of Crime Scenes
- Dora Garcia - Si pudiera desear algo (If I could wish for something)
- Ghyzlène Boukaïla - #31#
- Gohar Martirosyan - unlearning
- Gregor Božič - Monument aux arbres tombés
- Guillaume Thomas - Life damages the living
- Joachim Michaux - Sur tes cendres
- Joan Fontcuberta & Pilar Rosado - Beautiful Agony
- Julián García Long - Moheda
- Laure Prouvost - With Our elastic arms we drink deep sea blue to parlaient idéal
- Lou Le Forban - Le bal des choses
- Rony Efrat - Exemplaires
- Toshihiro Nobori - Subtile issue
- Yongkwan Joo - En attendant
- Younès Ben Slimane - Nous le savions qu'elles étaient belles, les îles
L'insaisissable peau
Nos vies nous mettent en face de l’autre, de son visage et de son corps. Cette expérience induit un espace auquel, tous les deux, nous apparte-nons. Celui du cosmos, de l’énergie que nous échangeons. Cette énergie est une pure dépense, un « abouchement » avec le monde.
Elle permet de pénétrer un univers qui ne se réduit pas à ce que l’on voit, à ce que l’on touche. Nous le connaissons par les effets de sa substance comme à travers les hypothèses qu’ils permettent.
La matière est là, investie par le virtuel qui la détermine, au point par-fois d’occuper toute la place, nous livrant aux vertiges des jeux et des métamorphoses. S’agit-il d’un pur insaisissable, désincarné, concept décliné en grappes d’idées ou en structures systémiques ? Non, car s’emparant de ces hypothèses, le rêve nous détrompe. Il est un passeur, pour une exploration « suspendue » d’espace en espace. L’emploi des mots peut éloigner l’incarnation mais n’oublions pas Icare et sa double nature entre ascension et gravité. Cette ambivalence nous conduit au sein des territoires de l’art. Ils sont l’équivalent du tableau de Brueghel l’ancien1, de celui de Daniel Pommereulle l’in-terprétant, ou de la poesis, comme le rappelle Yves Bonnefoy dans ses Entretiens 2 cités par un article à leur sujet3. Pour Yves Bonnefoy, la poésie [fait] « apparaître et vivre un lieu et un moment ». Cette apparition n’est pas aisée : « On a beau espérer délivrer les mots de leurs contenus conceptuels qui réduisent le monde à des figures abstraites et incomplètes, on restera toujours en deça de ce que Rimbaud nommait la vraie vie. »
Pour les créateurs, tout l’enjeu est là, car aujourd’hui le réel se présente sous forme de banques d’images, d’archives, de data, de processus de décryptage et d’encodage. Le réel s’élabore par des suites de suppositions et de compositions. Les problématiques d’un programme, d’un dessein, d’une symbolique débattent avec l’autogénération d’une forme « en soi ». Les figures de cette contradiction se lisent dans les ins-tallations, les scénarios, les performances, les films : figures d’une présence impalpable. Celles de ce « feu follet » qu’évoque Vladimir Jankélévitch : « Qu’on ne nous reproche donc pas la nature insai-sissable de ce feu follet puisque nous en faisons profession ! Nous professons ce dénuement. Notre science dénuée nous prive de tout point fixe, de tout système de référence, de contenus facilement déchiffrables ou délégables qui nous permettraient d’épiloguer, d’ali-menter le discours et d’ouvrir un long avenir de réflexion. Notre science nesciente est plutôt une visée, un horizon, elle a donc fait son deuil de la consistance substantielle en général. »
L’emploi d’une visée, la recherche d’un horizon, nous les vivons avec Panorama 23. En son centre, un pas de deux entre « le lieu et le moment » et un principe de déplacement, généré par un mouvement ayant fait le deuil d’une consistance substantielle. Ce pas de deux fertile dénote cet insaisissable par les volutes d’une « peau ».
De quoi est faite cette « peau » ? Disons, donc cette « étoffe » qui n’est pas le résultat d’un tissage d’idées. Est-ce un tapis volant ?
Il est fait d’espaces assemblés, de cartes, qui sont autant d’écrans qu’un instant je retiens.
Nous y suivons des embarcations semblables au Pequod d’Herman Melville, à des engins dans l’air, des véhicules de pensée ou des nuages qui filent.
Que nous offrent-ils ? Des frontières dépassées, des points aveugles et des renversements, en un mot, les dimensions mentales de l’uni-vers. Le futur infiltre le passé par effraction.
Notre environnement est un planétarium et nos phrases, nos images se multiplient dans d’étonnants kaléidoscopes.
Les œuvres du Fresnoy sont les formidables accélérateurs de nos circumnavigations au sein de la nature du monde. Elles appellent la liberté de ressentir et de penser.
Cette phrase d’Emanuele Coccia, pour son film, est une porte d’entrée idéale sur ces travaux : « Pour s’orienter dans ce ciel couché au sein de tout objet, il faut construire des cartes astrales à la manière des anciens. Apprendre à lire la matière comme on lit le ciel » ou, plus loin, « le ciel est la chair de tout ce qui existe. »
Ainsi une œuvre, grâce à l’intelligence artificielle, explore dans des textes sacrés l’intensité et la violence qui s’attachent au mot Dieu. D’autres pointent du doigt le « peu de réalité » de nos lexiques et syntaxes, de leurs interrelations sans objet, prolongements contemporains de la mécanique du Procès, des machineries de Kafka.
Une autre encore nous entraîne vers le nord, où le jour et la nuit se confondent sans fin, à partir d’une cartographie, d’un terri-toire reconstitué, interdit d’ap-proche sensible mais rétabli par les archives. Pure construction mentale, elle nous livre à la magie des ruines. Celle de bâtiments militaires, imaginés pour des stratégies de contre-espionnage, de défense, du « monde libre ». Sic transit gloria mundi. Ils ne sont plus que rêves d’une toute puissance oubliée, déplacés sur d’autres théâtres d’opérations.
Au détour des parcours, un « cube » minimal nous offre de jouer avec la vie de bactéries, en milieu clos, sublimée par une surface projetée. Invisible et fascinant écosystème à l’intérieur des corps.
Sur une autre scène, grâce à une technologie post-digitale, les objets s’évaporent et changent de substance. Employant toutes les res-sources contemporaines de l’image et du son, nos mots se cristal-lisent, le langage devenant transparent à lui-même. Nous le traversons et, dans l’espace soutenu par des lignes de chœurs, il est rythme volatile, fluidifiant la matrice linguistique.
Le réel, ici, est bien ce « tissu » tantôt diaphane, tantôt fantôme, promesse d’un ciel retourné, enterré, trésor au sein d’un champ où peuvent disparaître nos cinq sens, comme dans ce film où les vaisseaux spatiaux s’abîment en un fond océanique, ultra-abyssal, inaccessible. L’auteure de ce film4 propose cette phrase qui qualifie la poétique de ces travaux présents dans Panorama 23 : « Il s’agit d’observer le monde tel qu’il ne nous apparaît pas et d’inventer la possibilité de le redécouvrir. » Ou de le découvrir… encore…
Grâce à l’art, plus vivant que la nature elle-même, cette « peau insaisis-sable », ce voile sont une provocation au rêve qui les déchire, les outre-passe. Il ne s’agit pas de traverser les miroirs mais d’aller vers « l’autre » ; mais, cette fois, un autre sans visage et ne cessant d’apparaître, un « autre » entre l’obscur de la grotte et les lumières du ciel. L’autre vérité, n’est-ce pas le véritable nom de l’art ? L’art ne dit pas ce qui va arriver, il est un espace, sans début, sans fin, sans haut ni bas pour Orphée, mais, cette fois, pour un Orphée qui aurait le droit de se retourner.
Olivier Kaeppelin
- Agata Wieczorek - Growing
- Anhar Salem - Love & Revenge
- Charles Fosseprez - Quasimire
- Daniel Peñaranda Restrepo - Weather of Thresholds
- Dorian Nour Jespers - What is a rat without a tail?
- Emanuele Coccia - Heaven in matter
- Kendra McLaughlin - La plage aux êtres
- Lefebvre Zisswiller - État du langage
- Marie Sommer - Apories/Dew
- Moufouli Bello - Lissa, a conversation with God
- Olivier Jonvaux - Be Maybe May
- Stéphanie Roland - Le cercle vide